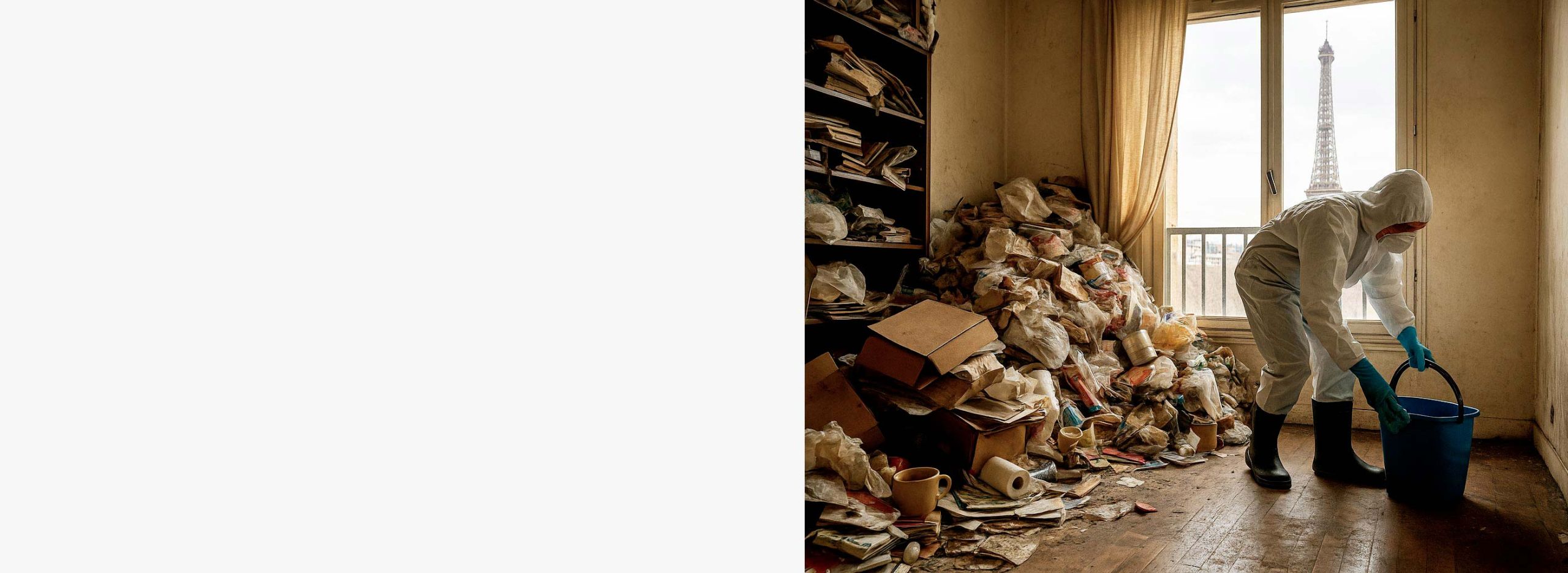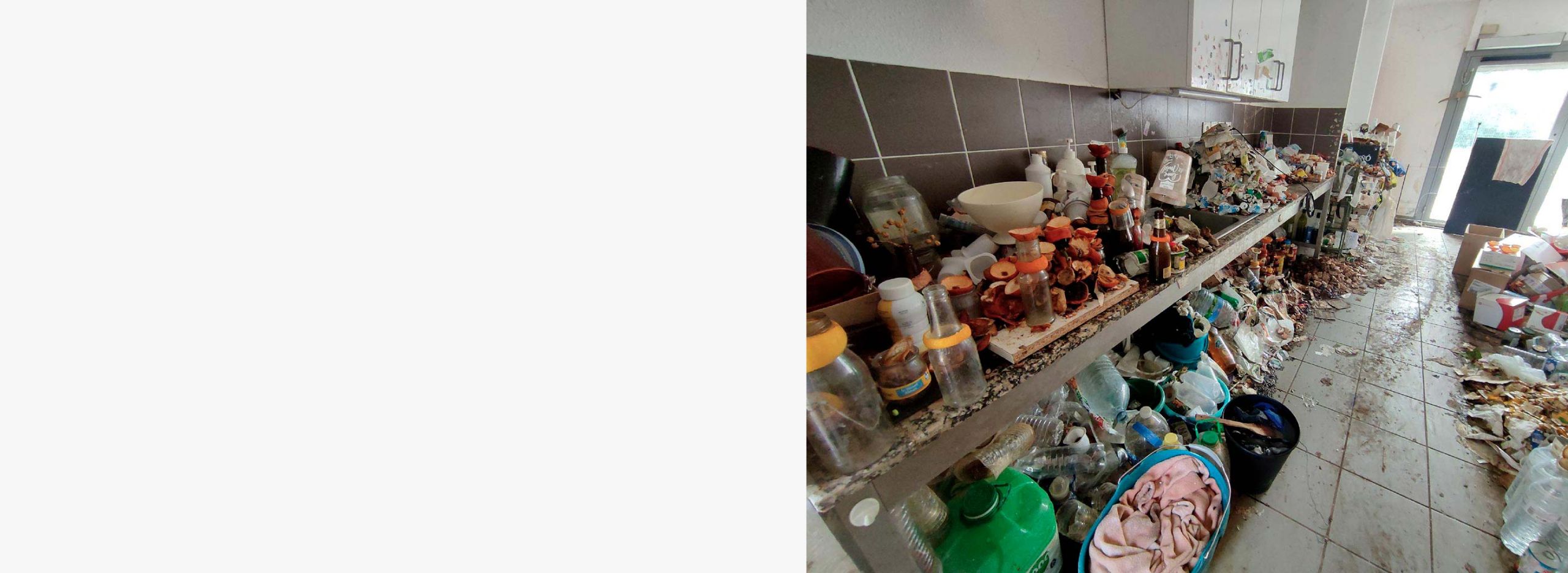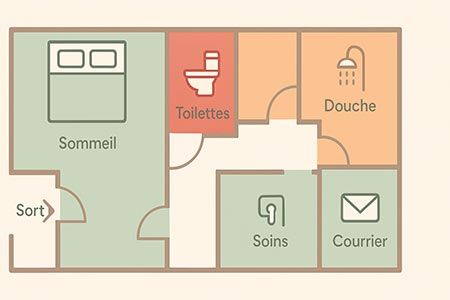Statistiques logement en Île-de-France
L’objectif de cette page est simple : proposer un panorama clair et utile des chiffres du logement en Île-de-France, avec des explications concrètes pour mieux comprendre ce que ces données signifient au quotidien. Les données proviennent de sources publiques de référence et d’équipes de recherche, sans visée commerciale, afin d’aider chacune et chacun à s’orienter, se repérer et, si besoin, trouver les bons interlocuteurs.
Comment lire les chiffres du logement sans se perdre
Les grands indicateurs du logement semblent arides, mais ils racontent des réalités très concrètes. Quatre notions clés permettent d’y voir plus clair.
Parc de logements : c’est l’ensemble des logements existants sur un territoire. Il se décompose en résidences principales, résidences secondaires ou occasionnelles, et logements vacants.
Statut d’occupation : être propriétaire occupant, locataire du parc privé, locataire du parc social, ou logé gratuitement.
Taille et peuplement : nombre de pièces et indice de peuplement qui classe chaque logement selon qu’il est suroccupé, dans la norme, ou sous-occupé.
Ancienneté et performance énergétique : l’année de construction et le diagnostic de performance énergétique influencent confort, charges et travaux possibles.
Ces notions structurent l’ensemble des statistiques ci-dessous et permettent de comparer des réalités très différentes selon les départements et les villes de la région.
Le parc de logements francilien en quelques repères
L’Île-de-France compte un parc résidentiel dense et majoritairement collectif. La région totalise plus de six millions de logements, dont une part très majoritaire d’appartements et une minorité de maisons. La part de résidences principales est très dominante, tandis que les résidences secondaires et les logements vacants forment des fractions plus limitées. Ces ordres de grandeur donnent tout de suite la mesure d’un territoire urbain, très construit et intensément habité.
Depuis le début des années 2010, le parc a continué de croître, porté à la fois par la dynamique démographique et par la baisse de la taille moyenne des ménages, deux leviers qui alimentent la demande de logements. Entre deux recensements récents, la progression des résidences principales s’explique pour moitié environ par la démographie et pour moitié par l’évolution de la taille des ménages.
Taille des logements et indice de peuplement
La région se caractérise par une présence marquée de petites surfaces : la part des studios et deux pièces est nettement plus élevée que la moyenne nationale, tandis que les grands logements familiaux sont proportionnellement moins nombreux, surtout dans les zones les plus denses.
L’indice de peuplement met en évidence une contrainte bien connue des ménages franciliens : la suroccupation. Une part non négligeable des logements est en suroccupation modérée, et une fraction plus réduite en suroccupation accentuée. Autrement dit, une part significative des résidences principales est trop petite au regard de la composition des ménages. Cette tension coexiste avec des situations de sous-occupation, notamment chez les ménages plus âgés, ce qui illustre une inadéquation structurelle entre tailles de logements disponibles et besoins.
Un parc ancien et très collectif
L’histoire urbaine laisse une empreinte durable : près de la moitié des résidences principales a été construite avant les années quatre-vingt-dix, dont des pans entiers durant les périodes de construction massive d’après-guerre. Cette ancienneté pèse sur l’accessibilité, la performance énergétique et le confort thermique, en particulier dans l’habitat collectif des décennies antérieures à la première réglementation thermique moderne.
Statuts d’occupation : propriétaires, locataires, parc social
Les modes d’occupation en Île-de-France diffèrent nettement de la moyenne nationale. La part des ménages propriétaires est plus faible qu’ailleurs, tandis que la part des locataires est plus élevée, avec un poids important du parc social. Ces équilibres traduisent le rôle central du locatif, en particulier dans les zones denses, et la place structurante du parc social dans l’accueil des ménages modestes.
La région compte plus d’un million de logements sociaux au sens du répertoire des bailleurs sociaux. Cela représente une proportion notable des résidences principales franciliennes, signe d’un effort historique et continu pour loger à loyers plafonnés dans un contexte de prix élevés. La quasi-totalité du parc social régional est collective et présente une structure plus riche en petites typologies, ce qui répond à une partie des besoins mais pose aussi la question des parcours résidentiels des familles.
Vacance et résidences secondaires : des parts limitées mais non négligeables
La part des logements vacants reste contenue à l’échelle régionale, tandis que les résidences secondaires ou occasionnelles pèsent une fraction modeste. Dans un marché tendu, ces proportions peuvent sembler limitées, mais elles se concentrent de manière inégale selon les territoires et les segments de marché. Une partie de la vacance est structurelle, liée à des travaux ou à des mises en vente, et une autre relève d’inadéquations temporaires entre l’offre et la demande.
Loyers du parc privé : niveaux et tendances récentes
Dans l’agglomération parisienne, les observatoires spécialisés mesurent des loyers médians au mètre carré nettement supérieurs à la moyenne nationale, avec des écarts importants selon les secteurs et la taille des logements. Les évolutions récentes montrent des hausses modérées mais significatives au regard de budgets déjà contraints par les dépenses de transport et d’énergie. Cette dynamique confirme un marché locatif privé toujours sollicité, où l’encadrement des loyers, la rareté des grandes surfaces et la qualité énergétique jouent un rôle croissant.
À Paris intra-muros, la dynamique récente a été légèrement plus soutenue que dans le reste de l’agglomération, avec une dispersion marquée entre quartiers selon l’état, la taille et la performance énergétique des logements. Les critères de confort et d’étiquette énergétique pèsent plus fortement dans les négociations, en particulier sur les petites surfaces.
Prix de vente et conjoncture immobilière
Après un net ralentissement en 2023, la conjoncture a montré des signes de stabilisation puis de reprise partielle en 2025, dans un contexte de détente progressive des taux. Les indicateurs notariaux font apparaître un redressement saisonnier des prix des maisons au printemps et en été, tandis que les appartements suivent des trajectoires plus différenciées selon les départements et la desserte en transports. Les anticipations à court terme restent prudentes, mais la correction entamée semble s’atténuer dans plusieurs segments.
Performance énergétique : un défi majeur en Île-de-France
La performance énergétique du parc francilien figure parmi les plus délicates du territoire national. La région concentre une part élevée de logements classés de E à G, avec une proportion de passoires énergétiques notable. La surreprésentation des petites surfaces et l’ancienneté du bâti expliquent une partie de cet écart. Ces constats ont des conséquences concrètes : factures plus élevées, inconfort en hiver comme en été, et contraintes réglementaires pour la mise en location.
Les politiques publiques intensifient la rénovation, et les statistiques récentes montrent une baisse des logements classés F et G dans plusieurs territoires, sous l’effet combiné des travaux et des évolutions réglementaires. L’effort à fournir reste néanmoins considérable pour aligner le parc sur les trajectoires climatiques et sur les exigences de décence énergétique qui s’échelonnent dans le temps.
Chauffage, confort et mobilité du quotidien
Le chauffage collectif urbain et le gaz restent dominants dans la région, devant l’électricité et un fioul en net recul. Ce mix pèse sur le niveau des charges et sur les stratégies de rénovation des copropriétés, notamment lorsque des réseaux de chaleur bas carbone deviennent accessibles et que leur extension permet des raccordements collectifs avantageux.
Côté déplacements domicile travail, l’Île-de-France se distingue par la prépondérance des transports en commun. La voiture reste importante mais moins dominante qu’ailleurs, tandis que la marche et le vélo progressent. Ces arbitrages résidentiels et de mobilité sont étroitement liés : la proximité des gares et axes structurants influence fortement la valeur d’usage d’un logement et son coût complet pour le ménage, en particulier lorsque le budget transport peut partiellement compenser un loyer plus élevé.
Construction neuve : après le creux, un redressement à surveiller
La filière a connu un net retrait des autorisations et des mises en chantier en 2023, point bas d’un cycle défavorable lié à la hausse des coûts et des taux. En 2024, la dynamique est restée fragile, avec une nouvelle baisse des autorisations en Île-de-France, avant des signes de reprise plus récents sous l’effet d’une détente financière, d’ajustements d’offre et de priorisations urbaines. Ces évolutions conditionnent l’arrivée future de logements et, par ricochet, les pressions sur les loyers et les prix dans les zones les plus tendues.
Zoom social : demande, attributions et tensions
La part élevée de logements sociaux en Île-de-France s’accompagne de tensions persistantes sur la demande. Les rythmes d’attribution progressent, mais la rotation reste faible dans les segments les plus recherchés, en particulier pour les familles et près des pôles d’emploi. Les synthèses régionales confirment ces tensions avec des indicateurs de vacance limitée, des délais d’attente souvent longs et des écarts selon les territoires et les typologies. Les politiques de peuplement, les mutations intra-parc et l’augmentation de l’offre adaptée aux familles constituent des leviers essentiels pour réduire ces délais.
Ce que cela signifie pour les ménages
Pour un ménage qui cherche à se loger dans la région, ces chiffres se traduisent par des réalités pratiques.
Trouver une surface adaptée : la suroccupation fréquente résulte d’un manque de grands logements abordables, notamment en cœur d’agglomération. Les familles sont davantage contraintes de s’éloigner ou de patienter dans le parc social.
Arbitrer entre budget et localisation : loyers et prix varient fortement selon l’accessibilité en transports en commun. Les économies sur la mobilité peuvent partiellement compenser un loyer plus élevé, et inversement.
Intégrer l’énergie dans le budget logement : les charges diffèrent selon l’étiquette DPE et le chauffage. Un logement apparemment plus cher mais bien classé peut coûter moins sur l’année qu’un logement moins cher à l’achat ou à la location mais énergivore.
Repères méthodologiques utiles
Résidence principale : logement occupé la majeure partie de l’année par le ménage.
Suroccupation : appréciée via l’indice de peuplement, qui confronte la taille du ménage et le nombre de pièces du logement. Les catégories vont de sous-occupation très accentuée à suroccupation accentuée.
Étiquettes DPE : classes A à G basées sur la consommation d’énergie et les émissions, utilisées pour fixer des obligations de décence énergétique en location dans un calendrier progressif.
Ressources publiques et pistes d’aide
Information et accompagnement : structures publiques et associatives d’information sur le logement, services sociaux municipaux, et dispositifs d’accompagnement à la rénovation pour informer sur les droits, les démarches, les aides financières et les recours possibles.
Logement social : informations sur la demande, les critères de priorité, les commissions d’attribution et les dispositifs de mobilité au sein du parc social. Les synthèses régionales aident à comprendre les volumes, les délais et les profils prioritaires.
Rénovation énergétique : dispositifs nationaux et locaux d’aide, accompagnement des copropriétés, diagnostics et travaux par étape en tenant compte de la réglementation en location et des économies d’énergie attendues. Les publications statistiques nationales et régionales permettent d’évaluer l’ampleur du besoin par type de logement.
Pour résumer
L’Île-de-France conjugue densité urbaine, poids du locatif, parc ancien et forte pression sur les petites surfaces. Le parc social joue un rôle stabilisateur majeur, mais la demande reste soutenue. La question énergétique est devenue centrale et conditionne les trajectoires du parc comme les budgets des ménages. Comprendre ces repères permet d’orienter plus sereinement un projet de location, d’acquisition ou de rénovation dans la région.
Sources officielles et académiques utilisées
Insee, exploitations récentes du recensement pour la région Île-de-France : parc de logements, statuts d’occupation, tailles des ménages, mobilité domicile travail, séries longues et dossiers régionaux.
Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement Île-de-France, répertoire des logements locatifs sociaux au premier janvier, analyses régionales.
Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, résultats de l’agglomération et bilans annuels sur les loyers médians.
Notaires de France et Chambre des notaires de Paris Île-de-France, indicateurs conjoncturels et prix standardisés des logements anciens.
Observatoire national de la rénovation énergétique et services statistiques ministériels, part des logements par classe de performance énergétique et dynamiques de rénovation.
Services statistiques du logement et de la construction, bilans des autorisations et des mises en chantier en Île-de-France.
- Créé le .
- Vues : 163